Un arrêt de travail n’est pas une simple absence. C’est une suspension temporaire du contrat de travail. Un salarié ne travaille pas, d’accord. Mais il est toujours un membre à part entière de l’équipe. Cette situation demande un soin tout particulier de la part des services RH. Un véritable numéro d’équilibriste. D’un côté, il faut gérer les obligations administratives et, de l’autre, préserver les intérêts de l’entreprise. Et par-dessus tout, veiller au respect des droits du salarié.
Les démarches administratives, étape par étape
Tout commence avec le médecin. C’est lui qui prescrit l’arrêt pour un motif médical. Cela peut être une maladie « ordinaire », une maladie professionnelle ou un accident du travail.
- Le salarié vous prévient : Il a 48 heures pour vous transmettre le volet n°3 de son arrêt de travail. C’est un document essentiel. Il justifie son absence et permet le versement des indemnités journalières.
- Dès que vous recevez le justificatif, agissez sans tarder. Établissez une attestation de salaire, un document indispensable pour la CPAM. Il est la base pour le calcul des indemnités du salarié.
Découvrez ici pour en savoir plus sur les démarches à effectuer par les salariés en arrêt de travail.
Un salarié en arrêt de travail peut-il être contrôlé ?
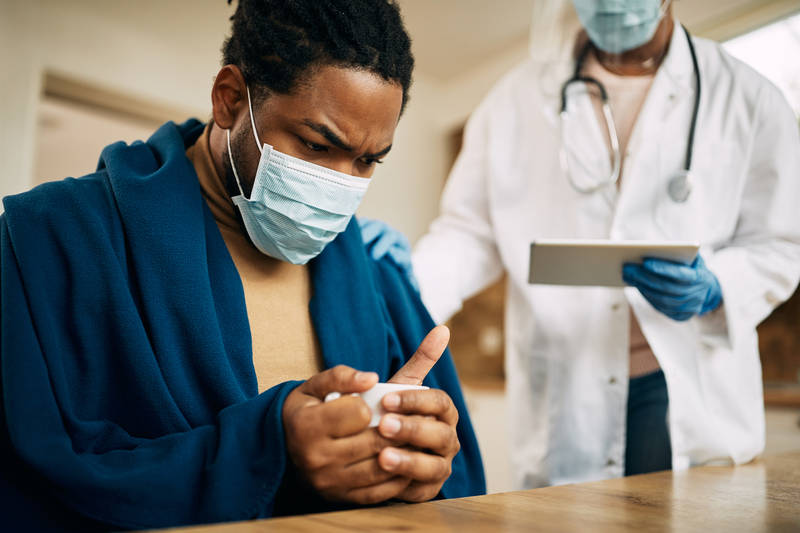
Un arrêt de travail peut désorganiser l’entreprise. C’est un fait. Et l’employeur est parfois contraint de verser un complément de salaire. Pour se protéger et éviter les abus, la loi autorise un contrôle médical. Cette « contre-visite » est facultative, mais elle peut être utile.
- Le médecin : Vous pouvez choisir librement le médecin qui effectuera le contrôle.
- La visite : Le médecin se rend au domicile du salarié. Il vérifie que l’employé est bien présent aux horaires indiqués sur son arrêt de travail.
- Les conséquences : En cas d’absence du salarié, vous pouvez cesser le versement des indemnités complémentaires.
Congés payés et arrêt de travail : ce qu'il faut savoir
La gestion des congés payés d’un salarié en arrêt peut prêter à confusion. Voici les règles de base :
- Arrêt pendant les congés : Si le salarié tombe malade pendant ses congés, ces derniers doivent être reportés. Sauf si la convention collective stipule le contraire.
- Si le salarié est en arrêt avant son départ, ses congés payés sont automatiquement reportés.
- Pour ce qui est du calcul des droits, sachez que l’arrêt de travail est bel et bien pris en compte. Et c’est le cas même si l’absence n’est pas liée à une maladie professionnelle.
Le maintien de salaire : quelles sont vos obligations ?
Faut-il continuer de payer un salarié en arrêt de travail ? C’est une question récurrente. La réponse est oui, sous certaines conditions. On fait référence aux indemnités complémentaires, ou plus pratiques au maintien de salaire. Pour pouvoir en profiter, le salarié doit en règle générale justifier d’une ancienneté d’au moins un an. Il doit également vous avoir prévenu dans les 48 heures.
Le mode de calcul dépend de plusieurs éléments, notamment de la convention collective.
- Pour une maladie ordinaire, un délai de carence de 7 jours s’applique. Après cela, vous devez compléter la rémunération de votre salarié. Le montant peut varier, passant de 90 % à 66,66 % du salaire habituel, selon l’ancienneté et la durée de l’arrêt.
- Pour une maladie professionnelle ou un accident du travail, le maintien de salaire est dû dès le premier jour, sans délai de carence. On parle de 90 % du salaire pour les 30 premiers jours d’absence. Ce pourcentage s’ajuste ensuite à 66,66 %.
Pour simplifier la gestion de la paie, l’entreprise peut opter pour la subrogation. Cela vous permet de percevoir les indemnités journalières directement de la Sécurité sociale, puis de verser au salarié la totalité de son salaire. C’est une démarche qui soulage l’employé des tracas administratifs.
Arrêt de travail et arrêt maladie : quelles nuances ?

On a souvent tendance à confondre ces deux termes, n’est-ce pas ? Pourtant, l’arrêt de travail est le terme général. Il désigne toute absence d’un salarié pour un motif médical, justifiée par un certificat. L’arrêt maladie, quant à lui, est une catégorie bien précise. C’est un type d’arrêt de travail. C’est une absence liée à une maladie ou à un accident non professionnel.
Par exemple, un arrêt pour accident du travail est différent. Il concerne une blessure qui arrive sur le lieu de travail ou sur le trajet. Lorsqu’il s’agit d’une maladie professionnelle, l’arrêt de travail découle directement d’une maladie liée à l’exercice des fonctions au sein de l’entreprise. En revanche, le congé maternité ou paternité suspend le contrat de travail, mais constitue un droit légal distinct d’une maladie. C’est donc la cause précise de l’absence qui constitue le critère essentiel de distinction.
Le retour au travail : comment s'organiser ?
Un salarié peut reprendre son poste de manière anticipée. C’est possible, mais sous certaines conditions. Un médecin doit d’abord donner son accord. L’employeur doit également être averti. Si l’arrêt dure longtemps (plus de 60 jours), une visite de pré-reprise devient obligatoire.
À son retour, l’employeur a aussi le devoir d’organiser une visite médicale de reprise dans les huit jours. Elle est nécessaire après un arrêt pour maladie professionnelle, après 30 jours pour accident de travail ou après 60 jours pour maladie ordinaire.
Quant à l’aménagement du poste, le médecin peut préconiser des aménagements. Il peut s’agir d’un mi-temps thérapeutique, ou d’un aménagement des conditions du poste de travail. L’employeur doit alors s’y conformer. Sauf si le médecin émet un avis d’inaptitude. Dans ce cas, un reclassement est nécessaire.
L'employeur peut-il envisager un licenciement ?
En principe, le contrat de travail est protégé pendant un arrêt de travail. On ne peut pas licencier un salarié à cause de son absence. Mais il existe deux exceptions, strictement encadrées par la loi.
- Le licenciement pour inaptitude : Un licenciement est possible si le reclassement du salarié s’avère impossible. C’est le cas si aucun poste adapté n’existe ou si le salarié refuse les propositions de reclassement.
- Le licenciement pour désorganisation de l’entreprise : Les arrêts répétés ou prolongés d’un salarié peuvent désorganiser l’entreprise. Dans ce cas, un licenciement devient une possibilité. Un employeur doit pouvoir démontrer que cette absence a désorganisé l’entreprise. Et que le recrutement d’un remplaçant en CDI est devenu absolument nécessaire.
Bref, la gestion des absences est un processus complexe. Elle demande de la rigueur administrative, mais aussi de l’humanité. Comprendre les règles, c’est mieux protéger l’entreprise. Et c’est aussi mieux accompagner le salarié. Une approche bien gérée renforce la confiance et le bien-être au travail. Alors, pourquoi ne pas revoir vos procédures internes ?


